ENS LSH - Colloque - Pour une histoire critique et citoyenne, le cas de l’histoire franco-algérienne
Pour une histoire critique et citoyenne
Le cas de l’histoire franco-algérienne
20, 21, 22 juin 2006
GUIGNARD Didier
Maison méditerranéenne des Sciences de l’homme
La mise en place de l’administration coloniale en Algérie (1880-1914)
Mardi 20 juin 2006 - Matin - 9h45-11h45 - Amphithéâtre
Les débuts de l’administration française en Algérie remontent à 1830. Le régime militaire des « bureaux arabes » s’applique progressivement à l’ensemble du pays conquis même si, dès les années 1830-1860, des îlots d’administration civile émergent autour des villes principales. C’est cependant le régime civil, après 1870, qui encadre durablement le quotidien des Algériens. Les républicains souhaitent en finir avec les expériences des militaires et du Second Empire pour assimiler l’Algérie, colonie de peuplement européen, à la France métropolitaine. En quinze ans (1870-1884), ils bouleversent ainsi l’administration coloniale. Le corps des agents de l’État est entièrement renouvelé suite à l’épuration républicaine, à la promotion de nouveaux auxiliaires algériens et à la généralisation des élections locales. Le territoire civil triple en superficie entre 1873 et 1881 pour s’étendre à l’ensemble du Tell[1]. 75 communes « mixtes » et 209 communes « de plein exercice » réunissent déjà plus de huit habitants sur dix en 1884[2] et repoussent l’administration militaire sur les marches sahariennes et aux frontières. Ces communes ne ressemblent guère à celles de métropole. Les premières sont des unités immenses de 1 000 kilomètres carrés et 25 000 habitants en moyenne, où sont regroupés les deux tiers des sujets algériens mais seulement un citoyen français sur dix. Les administrateurs, nommés à leur tête, sont munis de pouvoirs disciplinaires et remplissent à la fois les fonctions de maire et de sous-préfet. Les secondes sont l’aboutissement du processus d’assimilation mais, avec une superficie moyenne de 90 kilomètres carrés, elles sont encore cinq fois plus grandes qu’en France. Surtout, bien qu’elles réunissent neuf citoyens français sur dix, les sujets algériens y sont encore largement majoritaires, dans la plupart des cas. Elles sont pourtant administrées par des conseils municipaux dominés par les élus français. En effet, les lois municipales et départementales ont été promulguées en Algérie (1875-1884) assorties de dispositions spéciales pour garantir la domination française. Cette géographie administrative reste mouvante à la fin du siècle : le nombre des communes de plein exercice croît rapidement par l’adjonction fréquente, à l’intérieur des communes mixtes, de plusieurs douars aux centres de colonisation. Cela permet de constituer l’assise budgétaire des nouvelles communes. Au nom de l’assimilation toujours, les services algériens sont rattachés aux différents ministères parisiens (1881), ce qui aggrave la dispersion des responsabilités et rend plus difficile le contrôle de l’administration. Les sujets algériens sont partout soumis au régime de l’« indigénat », c’est-à-dire à une liste d’infractions et de peines spéciales, approuvée par le Parlement en 1881, qui conditionne leur lieu de résidence, leurs déplacements, leurs contributions (réquisitions, gardes, « impôts arabes ») et leur parole. Enfin, dans une colonie où l’agriculture et l’élevage constituent la principale richesse, l’administration des années 1870-1890 accélère considérablement la dépossession foncière des autochtones au profit du Domaine et des colons. Elle s’y emploie par le séquestre, l’expropriation et la francisation de la propriété. Ce dernier processus résulte de l’application du sénatus-consulte de 1863, des lois foncières de 1873 et de 1887 qui facilitent la constitution de la propriété individuelle et privée et donc la vente des meilleures terres au bénéfice d’Européens.
Cette mise en place des structures administratives est bien connue[3]. Ce qui l’est moins et m’intéresse davantage, c’est la « crise » du régime républicain qui a suivi[4]. Elle a pour moteur, dans les années 1890, la multiplication des scandales d’abus de pouvoir dans la colonie qui impliquent des fonctionnaires français et algériens, des auxiliaires et des candidats au pouvoir local. Ces scandales contrarient cette genèse administrative qui se voulait durable, en rupture avec les abus des régimes antérieurs - turc ou militaire. Ils y participent aussi pleinement. Près de 300 « affaires »[5] de corruption et de violence, entre 1880 et 1914, contredisent bruyamment le discours civilisateur des républicains, d’autant plus que trois sur quatre sont traitées par les autorités sur une période de quinze années seulement (1888-1903). Les mêmes pratiques déviantes - au regard des normes juridiques, morales ou sociales de l’époque en métropole - se répètent et sont souvent associées dans une affaire : clientélisme, népotisme, concussion, trafic d’influence, détournement ou gaspillage d’argent public, corruption électorale, travail forcé, amendes et emprisonnement arbitraires, agressions multiformes, spoliation des biens, etc. Par leur ampleur et par l’imbrication des échelles, ces abus donnent beaucoup à voir du fonctionnement de l’État : de la cave de 40 kilomètres carrés à Grarem où sont enfermés 63 Algériens en 1900, pour non-paiement de l’impôt, jusqu’aux bancs du Parlement et aux rédactions parisiennes, étrangement muets à cette date[6]. Quelques années plus tôt, ce genre d’affaire aurait fait la une des journaux en effet et l’objet d’une interpellation retentissante. Pourquoi cette différence de traitement ?
La difficulté du sujet réside dans sa documentation[7] : beaucoup d’abus restent cachés ou renseignés dans le cadre déformant de l’État colonial. Ce sont, par exemple, des plaintes édulcorées sous le régime de l’« indigénat », des rapports d’enquêtes partiels et partiaux, les dénonciations mesurées de tel député « indigénophile » car toujours patriote et colonialiste, etc. Mais, paradoxalement, l’« archive coloniale » est riche de ses propres limites. En effet, sa production évolue selon l’espoir des plaignants d’être entendus, la proximité de l’enquêteur avec les abuseurs, le niveau d’indignation et la volonté politique à découvrir et à sanctionner. De plus, sur douze années de crise aiguë (1891-1903), ce noyau d’archives livre des contenus souvent très détaillés avec des révélations qui remontent le temps. Au début du xxe siècle, son silence est encore relatif : des notes administratives - non destinées à être lues - ou des comptes rendus parlementaires fourmillent d’indices pour renseigner la manière d’éviter le scandale.
La genèse de l’administration coloniale en Algérie peut donc être saisie, au tournant des xixe-xxe siècles, parce que des pratiques administratives se forment et que leurs perceptions évoluent des deux côtés de la Méditerranée. Une mesure des abus de pouvoir est possible et, ce faisant, de la singularité coloniale ou algérienne en la matière. En effet, la comparaison reste indispensable avec les abus commis, à la même époque, en métropole, dans d’autres colonies ou pays. Enfin, il s’agit de rendre compte des réponses apportées par le régime républicain dans sa période d’enracinement, pour « normaliser » son administration coloniale en Algérie.
Mesure des abus et chronologie de la crise (1880-1914)
La mesure proposée est forcément inférieure à la réalité des abus commis. Pour qu’ils soient retenus dans la statistique, cela suppose qu’ils aient fait l’objet d’une plainte, d’une enquête qui les établisse comme tels et d’une sanction effective, selon plusieurs procédures : administrative, judiciaire, parlementaire, financière. Cela suppose encore qu’ils aient laissé une trace dans les archives ! Notre recensement se limite ici aux seuls fonctionnaires municipaux, nommés ou élus, ayant fait l’objet d’une sanction ou d’une condamnation, à savoir : dans les communes de plein exercice, les conseillers municipaux au titre « français » et « indigène », les maires et leurs adjoints ; dans les communes mixtes, les membres des commissions municipales, les adjoints spéciaux des centres de colonisation, les administrateurs et leurs adjoints. Pour la période 1880-1914, 19 fonctionnaires seulement sont condamnés par les tribunaux pour abus de pouvoir, mais les sanctions administratives sont beaucoup plus nombreuses : 96 suspensions par arrêté préfectoral, 44 suspensions sur décret du ministre de l’Intérieur, 80 révocations et 39 dissolutions de conseils municipaux par décret présidentiel, enfin 125 annulations d’élections municipales, partielles ou totales, sur arrêt du conseil d’État. D’autres sanctions échappent au décompte parce que l’archive fait défaut pour les renseigner. C’est le cas, en particulier, des sanctions officieuses ou des arrêtés des conseils de préfecture qui jugent, en première instance, le contentieux électoral. Certaines nous sont connues indirectement : 14 blâmes, 8 déplacements ou retraites anticipées et 4 annulations d’élections municipales par les conseils de préfecture, sans pourvoi au conseil d’État.
Cela signifie, qu’entre 1880 et 1914, au moins une commune de plein exercice sur deux et deux communes mixtes sur cinq sont touchées - et souvent à plusieurs reprises - par une affaire d’abus de pouvoir instruite et sanctionnée. 44 % de la population recensée dans la colonie en 1896[8] réside dans l’une de ces communes, dont 36 % des sujets algériens et 92 % des citoyens français. Pour retrouver des chiffres comparables en France métropolitaine, il faut s’arrêter aux vagues d’épuration de 1877-1883[9]. Mais celles-ci sont motivées par des critères idéologiques alors que les fonctionnaires d’Algérie se disent tous « républicains » à la fin du siècle et sont, presque toujours, reconnus comme tels. De plus, il n’y a pas de géographie des affaires en fonction de l’isolement relatif des communes touchées - même si cela peut jouer un rôle localement -, de l’importance et de la composition du peuplement communal, de la nature des abus révélés. La règle, c’est la généralisation et la dispersion des cas. De nombreux témoignages viennent appuyer ce constat. Ils sont le fait, notamment, de hauts fonctionnaires qui s’efforcent d’éviter toute publicité. Le secrétaire général du gouvernement d’Alger avoue ainsi son impuissance dans une note datée de 1906 :
Nous sommes malheureusement fondés à affirmer que si on devait révoquer tous les maires d’Algérie qui falsifient les états de recensement pour faire bénéficier leur commune d’un supplément d’octroi de mer ou tous ceux qui nous fournissent de faux décomptes de frais d’hospitalisation dans le but de voir augmenter les subventions que la colonie leur alloue, les révocations seraient nombreuses.[10]
Une géographie plus opérante est celle qui distingue les lieux où se produisent des révélations, selon le type d’administration et la nature du lien politique. En effet, le processus de crise qui conduit à la découverte d’abus est plus actif là où le pouvoir local est enjeu d’élections et où la liberté de parole est plus grande - du moins pour la minorité jouissant des droits civiques : en territoire civil plus qu’en territoire militaire, dans les communes de plein exercice plus que dans les communes mixtes. Cela dépend aussi de la capacité des patrons locaux à étendre et à tenir leur clientèle pour éviter les plaintes, le bruit sur les affaires et les sanctions. Ainsi le département d’Oran, tenu par le tout puissant député Eugène Étienne, plusieurs fois ministre au cours de la période, résiste mieux aux scandales que celui de Constantine, où des clans rivaux se disputent violemment le pouvoir, sans être capables de s’imposer.
De plus, ce processus de découverte et de sanction évolue au cours du temps et rythme la crise. Les affaires se multiplient au tournant des années 1880-1890 pour atteindre un pic en 1897 : 27 sont alors instruites et sanctionnées (cf. figure 1). Le sommet de la crise est atteint en 1901 si l’on se réfère à la somme des administrés concernés dans chaque affaire sanctionnée : près d’un demi-million à cette date (cf. figure 2).
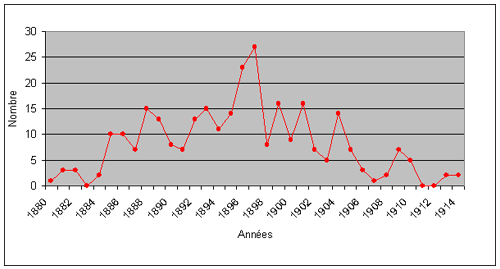
Figure 1 - Affaires d’abus de pouvoir sanctionnées impliquant des fonctionnaires municipaux en Algérie : conseillers, maires, administrateurs et adjoints (1880-1914).
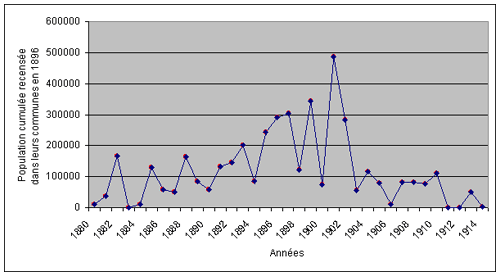
Figure 2 - Population concernée par les fonctionnaires municipaux sanctionnés pour abus de pouvoir en Algérie : conseillers, maires, administrateurs et adjoints (1880-1914).
1901 est en effet une année d’élections municipales et le conseil d’État ne chôme pas pour annuler les scrutins irréguliers à Oran, Aïn M’Lila (commune mixte), Blida, Miliana, Mouzaïaville, Hussein Dey, Cheragas ou Aïn el Turk. Dans un contexte très agité depuis 1898, les violences de rue recommencent à Alger, encouragées par la municipalité antisémite : deux adjoints sont sanctionnés dont celui chargé de la police. À cela s’ajoute le quota presque ordinaire d’élus corrompus. Le maire de Ténès, par exemple, a bâti sa fortune en pratiquant l’usure auprès de pèlerins musulmans et de fellahs dépourvus de semences, en détournant 3 000 francs de subventions destinés aux indigents et en taxant les cafés maures[11]. Les faits remontent à 1897 au moins, mais l’enquête et la révocation ne sont décidées qu’à cette date. Après 1903, le processus s’enraye : les plaintes parviennent plus difficilement aux destinataires ; les enquêtes sont moins souvent décidées ; les journaux s’intéressent à autre chose et le pouvoir central - entre Alger et Paris - s’emploie à éviter tout nouveau scandale. C’est ainsi par hasard, sans la moindre plainte, que le sous-préfet de Philippeville a vent en 1913 des abus du maire de Gastonville - aujourd’hui Salah Bouchaour au sud de Skikda. À la suite de vols répétés dans la commune, l’élu français a décidé de rendre lui-même la justice, en désignant les sujets algériens coupables et en leur infligeant des amendes. Le procureur général à Alger est d’avis de poursuivre « pour éviter le retour de pareils procédés qui, si j’en crois ce que l’on m’a dit, sont choses courantes dans la commune[12] ». Mais le ministre de l’Intérieur se range bientôt à l’avis du gouverneur général et du préfet de Constantine pour éviter toute poursuite judicaire et limiter la sanction administrative à des « observations sévères » :
Il semble évident, plaide le préfet, qu’il ne s’est pas rendu compte qu’en agissant comme il le faisait, il s’arrogeait des pouvoirs qu’il n’avait pas et que la perception autorisée par lui de redevances illégalement exigées constituait le délit de concussion [...].[13]
Le fonctionnaire insiste également sur les liens qui unissent le maire au député de Constantine, Gaston Thomson, ministre de la Marine dans les gouvernements radicaux de Rouvier et de Clemenceau (1905-1909). Ce cas d’impunité n’est pas isolé ; il est même devenu la « norme » dans l’administration républicaine de la colonie depuis une décennie.
Les conditions d’émergence et de sanction des affaires (1880-1897)
À la fin du xixe siècle, le contexte socio-économique, politique et culturel est favorable à l’avènement du scandale public dans le monde « développé »[14]. Cette forme nouvelle de contestation est liée à la fois aux progrès du capitalisme industriel et bancaire, à la « Grande Dépression », à l’impérialisme et à la démocratisation relative de la vie politique - alphabétisation avancée des populations, libéralisation de la presse dont le prix diminue avec l’apparition des quotidiens à grand tirage. Ainsi, les « scandales algériens » interagissent avec ceux du Panama ou de l’affaire Dreyfus, mais ils sont aussi contemporains de la dénonciation des violences coloniales au Congo belge[15] ou du système de corruption politique aux États-Unis (bossism)[16], etc. Dans la France des années 1880, la République des hommes d’affaires[17] subit les assauts redoutables des oppositions de droite ou de gauche et doit répondre aux inquiétudes d’une opinion, de plus en plus soupçonneuse en matière d’argent public. Le Parlement rechigne à augmenter les crédits outre-mer, qui ne font pas gagner beaucoup d’électeurs avec la crise économique, et dont l’utilisation est difficile à contrôler. Dans ce contexte, le publiciste Édouard Drumont obtient un grand succès avec son violent pamphlet antisémite : La France juive - Essai d’histoire contemporaine(1886). Il synthétise toutes les préventions contre la République bourgeoise, qu’il relie systématiquement à « un complot juif-allemand [...] dont la finance internationale tient tous les fils[18] ». Dans ce best-seller, plusieurs pages sont consacrées à la corruption dans les colonies, au « scandaleux » vote communautaire des Juifs algériens - citoyens français depuis 1870. À partir de 1892, son journal La Libre Parole déterre l’affaire du Panama puis se spécialise, avec d’autres quotidiens, dans le commerce des « petits papiers » pour déstabiliser le régime. La dénonciation des « scandales algériens » participe donc à cette entreprise.
Dans la colonie, les ressources associées à un mandat électif (rémunération, distribution des faveurs, pouvoir sur les hommes) dépassent de beaucoup celles de métropole pour des fonctions homonymes, ce qui attise les appétits. Les candidats au pouvoir reprennent les thèmes développés par Drumont qui sont le moyen de fragiliser les clientèles en place : ils stigmatisent l’appoint de voix juives et dénoncent les abus de pouvoir. Ce faisant, ils attirent un électorat européen plus populaire d’ouvriers, de petits colons, employés ou fonctionnaires. Cette clientèle se développe sous l’effet de la loi de 1889 qui fait des Européens étrangers, nés en France ou en Algérie, des citoyens à leur majorité. Ainsi les plaintes se multiplient dans la colonie vers 1890, et sont moins le fait de sujets algériens - majoritairement victimes des abus - que de Français ambitieux ou revanchards : migrants aventuriers sans le sou, clients infidèles, subordonnés haineux, entrepreneurs ou propriétaires lésés dans leurs intérêts. La grande liberté de parole dont ils sont les seuls à bénéficier après 1881, comme citoyens français, leur permet d’en abuser. En effet, même si de nombreux faits dénoncés sont établis après enquête, la calomnie, l’injure ou la diffamation s’étalent à longueur de colonnes dans de mauvaises feuilles, créées au début d’une campagne électorale et qui survivent ensuite difficilement. Chargé d’une enquête sur l’administration du maire de Mustapha, un conseiller de la préfecture d’Alger dresse ainsi le portrait du principal plaignant, le Dr Bernard, premier adjoint :
Je ne veux pas défendre M. Bernard ; il n’a cessé de hurler avec les loups que le jour où on l’a obligé à reverser l’indemnité de maire qu’il avait indûment encaissée. M. Bernard n’est vraiment pas intéressant, mais, en définitive, il défend les droits qu’il tire de la loi.[19]
La convergence d’intérêts entre les antisémites de France et d’Algérie se concrétise par une alliance politique en décembre 1895. Jean Drault, rédacteur à La Libre Parole, couvre l’énorme scandale des concessions de phosphates de Tébessa et noue des contacts avec l’opposition radicale et antisémite de Constantine. La campagne de presse contre les élus corrompus redouble d’intensité en Algérie et en France ; des professionnels de l’agitation provoquent des violences antisémites à Mostaganem et à Oran[20] (1897) puis surtout à Alger[21] (1898). Le pouvoir local tombe rapidement entre leurs mains : ils décrochent quatre sièges sur six à la Chambre - avec Drumont élu député d’Alger -, obtiennent la majorité dans les trois conseils généraux et dans les villes principales (Alger, Oran, Constantine, etc.).
Paradoxalement, ce coup de force des antisémites a été facilité par les républicains du gouvernement. Le sénateur radical Louis Pauliat profite d’une interpellation en février 1891 pour faire le procès, en quatre séances, du régime d’assimilation, synonyme d’abus multiples contre les sujets algériens. Le débat a un énorme retentissement et Jules Ferry, en personne, s’empresse de réagir. Comme acteur principal de l’expansion coloniale française des années 1880 et de sa justification républicaine, il propose la nomination d’une grande commission d’enquête à l’anglaise, chargée de proposer des réformes pour « la consolidation de cette grande œuvre nationale et civilisatrice » :
Il faut, Messieurs, que la commission [...] fasse sortir le Parlement de ces habitudes d’indifférence. Le grand malheur de l’Algérie, c’est qu’elle n’est pas assez connue.[22]
L’un de ses protégés, Jules Cambon, hérite du poste de gouverneur général (1891-1897) avec pour tâche d’accompagner les réformes et de débarrasser l’administration des « brebis galeuses ». À la fin du xixe siècle, les parlementaires portent une attention nouvelle à l’Algérie et à ses abus (cf. figure 3).
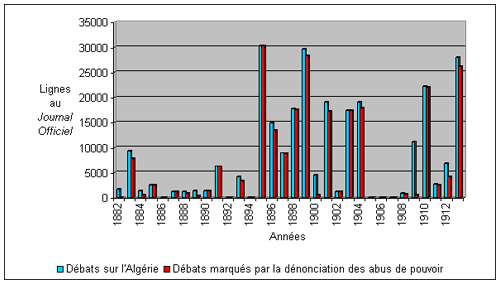
Figure 3 - Attention portée à l’Algérie et aux abus de pouvoir locaux dans les débats de la Chambre des députés (1882-1913).
Les révélations sont particulièrement craintes ou attendues. C’est le cas à la Chambre des députés au moment des votes budgétaires de 1891, 1893, 1895, 1896, 1898 et 1900 ; avec les interpellations sur l’affaire des phosphates (1895), sur les réformes administratives (1896), sur les troubles d’Alger (1898), sur l’élection du député Thomson (1898), sur la situation générale dans la colonie (onze séances de mai à juin 1899 !), etc. Les opposants à la République tiennent là son talon d’Achille. Monarchistes, anciens boulangistes, nouveaux nationalistes et socialistes se relaient ainsi à la tribune. Une poignée de parlementaires « indigénophiles » s’efforcent aussi d’éveiller les consciences, au nom des grands principes. Mais, dans l’atmosphère patriotique de l’époque, aucun interpellateur ne remet en cause la domination coloniale : les plus critiques insistent plutôt sur la « conquête morale » des populations « indigènes ».
Avec cet espoir limité mais nouveau d’être entendus, les sujets algériens se plaignent davantage des abus dont ils sont victimes[23]. La forme de ces plaintes et les réponses apportées trahissent d’autres abus : le régime de l’« indigénat » oblige à adopter un ton respectueux des autorités et à dépasser la peur car les fonctionnaires mis en cause peuvent exercer des représailles. Le recours à l’écrivain public, à l’interprète ou à l’avocat coûte cher et contribue à aseptiser davantage les griefs. Enfin la plainte « indigène » est souvent le résultat d’une manipulation des signataires par des candidats français ou algériens au pouvoir local. Quand l’enquête est décidée, la découverte des abus dépend encore de la procédure et de la qualité des enquêteurs. Ces derniers sont confrontés à des difficultés sur le terrain, liées à la peur ou au conditionnement des témoins, à l’effacement des traces ou à la difficulté à faire la preuve. Leur rapport se cantonne souvent au registre juridique, respectueux des hiérarchies et relativement complaisant avec les abuseurs. Mais il produit parfois une analyse critique de la situation qui dépasse le cas enquêté. Recopié, raturé, il est rarement ignoré des autorités supérieures qui décident de la suite à donner.
Cependant, le fonctionnement de la justice en Algérie aboutit généralement à des non-lieux ou à des peines ridicules. La seule procédure efficace est administrative et devient l’arme principale du gouverneur général Cambon. Son emploi reste délicat car elle remet en cause le mythe de l’État impartial et bientôt l’État lui-même, étant donné la somme de fonctionnaires compromis. Cette politique de sanction est encore soumise au bon vouloir de l’administration préfectorale, malmenée par les affaires, et à celui des gouvernements successifs à Paris. Les sanctions sont enfin peu dissuasives car, devenues un enjeu des luttes politiques locales, elles provoquent une surenchère d’abus : plaintes et articles diffamatoires, interventions directes d’élus auprès du ministère pour empêcher ou presser la sanction, violences sur les témoins, troubles antisémites, élus sanctionnés et aussitôt réélus, etc.
La singularité des abus de pouvoir en Algérie (fin xixe siècle)
En 1895, un Français d’Algérie se plaint de l’image donnée de la colonie avec la multiplication des scandales :
La concussion, la prévarication, constitueraient la morale des Français habitant l’Algérie ! Il faudrait cependant se rappeler qu’au-delà comme au-deçà de la Méditerranée, les errements administratifs sont identiques.[24]
Le régime de l’assimilation emprunte à la métropole une partie de ses institutions démocratiques, dont l’appropriation conduit en effet à des abus similaires en France, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis : fraude électorale, clientélisme et corruption[25]. Mais le régime institue aussi en Algérie la domination et l’exploitation avec des abus caractéristiques de beaucoup d’autres colonies : travail forcé, mainmise sur les terres, appauvrissement de la masse des colonisés, cas de séquestration ou de torture, corruption, fraude électorale[26], etc. Or, c’est justement cette hybridité institutionnelle qui génère des pratiques originales en Algérie. La singularité est même renforcée, à la fin du xixe siècle, par une donnée conjoncturelle : l’ampleur du chantier colonial avec la construction et le financement des routes, des voies de chemins de fer, des ports ou des édifices urbains. Cette colonie de peuplement réunit donc, au milieu des années 1880, une somme impressionnante de « facilitateurs » d’abus[27], auxquels les agents de l’État ont souvent bien du mal à résister.
La tentation réside d’abord dans le quasi-droit d’abuser. La frontière du permis est brouillée par la légitimation dans la colonie de ce qui, en métropole, serait considéré comme abus. La mainmise sur une partie importante des ressources autochtones (terres, forêts, eau, sous-sol, troupeaux, argent) « respecte la loi » ; de même que l’encadrement et le contrôle de la population « indigène » (amendes collectives, facilités d’emprisonnement, internement). La diffusion en Algérie de la procédure française favorise aussi les abus du fait de son coût et de son incompréhension par beaucoup de colonisés. Dès lors, le passage à des « abus illégaux » est souvent insensible chez des fonctionnaires habitués aux lois d’exception dans l’administration des biens et des personnes. La tentation d’abuser gît encore dans la définition du droit, plus incertaine en Algérie qu’en France. Depuis 1830, le droit colonial est produit avec des logiques de domination très différentes, sans la moindre codification. À la fin du siècle, c’est un imbroglio de droits réservés : « musulman », « français », « spécial » à l’Algérie, « commun » avec la métropole, alors que le cloisonnement total des personnes et des biens est impossible. Les juristes s’épuisent en controverses pour définir, selon les lieux, la nature de la propriété ou les modalités de « représentation indigène ». Les fonctionnaires improvisent eux-mêmes des réponses qui se contredisent, sous la forme d’arrêtés ou de circulaires. Certains profitent aussi de leur connaissance des failles juridiques et des facilités de procès offertes pour s’enrichir. Ces tentations sont d’autant plus fortes que l’impunité est presque assurée avec la faiblesse du contrôle administratif, judiciaire ou financier. Des circonscriptions immenses sont parcourues par un personnel insuffisant avec des difficultés de transport persistantes. De plus, le recrutement des agents de contrôle laisse beaucoup à désirer, comme le démontre une étude prosopographique du personnel préfectoral[28]. Ces fonctionnaires, chargés généralement des enquêtes, de la justice administrative et des propositions de sanction sont généralement moins qualifiés, moins scrupuleux ou moins motivés que leurs collègues métropolitains. Les départements d’Algérie constituent un « placard » redouté d’où il est difficile de s’échapper avec ses fièvres, la lenteur des mutations et la faiblesse relative des traitements - en dépit du quart colonial. Les postes occupés par ces mêmes fonctionnaires en métropole, avant ou après leur séjour algérien, soulignent leur moindre considération : c’est la France des campagnes isolées qui domine. Leurs derniers espoirs résident dans les élus de la colonie qui décident des carrières. Ils y perdent souvent le peu d’indépendance ou d’honnêteté qui leur reste, même s’il y a des exceptions. Un autre profil est celui de fonctionnaires français, nés ou arrivés jeunes dans la colonie, ayant gravi tous les échelons sur une vingtaine d’années : commis, sous-chef puis chef de bureau, administrateur adjoint puis principal dans plusieurs communes mixtes, conseiller de préfecture enfin. L’obtention d’une sous-préfecture couronne leur carrière algérienne. Le milieu colonial n’a plus de secret pour eux mais la « valeur » professionnelle qu’on leur attribue est souvent proportionnelle à la crainte qu’ils inspirent aux sujets algériens.
La singularité du régime local tient encore à la force du clientélisme politique. Il est favorisé par la pauvreté de la masse des Algériens et de nombreux migrants européens, prêts à tout pour obtenir une parcelle à cultiver ou un emploi. Comme l’administration ou l’élection dispensent ces faveurs, on assiste à une « ruée vers le politique » dans les années 1880, encouragée par des exemples d’ascension sociale rapide ayant pu dépasser les contraintes liées au statut des personnes - « indigène » ou étranger. La disproportion très grande dans chaque commune entre le nombre d’électeurs et d’administrés est un facteur aggravant pour le clientélisme. Quelques dizaines de voix suffisent pour être élu maire, conseiller général ou sénateur d’une circonscription démesurée et souvent très peuplée. Il n’est pas rare qu’une élection importante se joue avec moins de dix voix d’écart. De plus, un quart des électeurs français de la colonie sont fonctionnaires à la fin du siècle. Pour conquérir le pouvoir ou s’y maintenir, la tentation est grande de faire pression sur les électeurs, de les enrôler comme clients ou d’acheter leurs suffrages. Le milieu politique s’organise en clans qui s’entre-déchirent au moment des élections. Les çoffs algériens se mettent à la remorque des « partis » français ; la compétition, généralement violente, coûte également cher. Ce sont donc les plus riches et les « gros bras » qui s’imposent. Certains patrons sont capables d’imposer durablement le silence dans une commune par la distribution d’emplois, de secours, de chantiers ou de locations de terres, mais aussi par la menace permanente de peines d’amendes ou de prison en application du « code indigène ». Ces tyrans de village entrent dans la clientèle d’élus plus puissants, capables de les couvrir en échange d’un soutien aux élections départementales ou nationales.
Les affaires permettent aussi de suivre les flux d’argent, licites ou illicites. La colonie se caractérise par des besoins énormes pour financer le chantier colonial et faire face aux catastrophes, plus ou moins naturelles : sécheresse, invasion de criquets, phylloxéra, épidémie et famine. Or les fonctionnaires locaux obtiennent et dépensent plus facilement qu’en France l’argent public par le biais d’une fiscalité originale (« impôts arabes », taxes spéciales, nombreuses exemptions pour les contribuables européens) et par la distribution massive de subventions, de secours ou d’emprunts. Jusqu’à 1891, le Parlement vote les budgets algériens sans même les discuter et l’inspection des finances ne dispose pas de moyens d’investigation suffisants dans la colonie[29]. La lourdeur des « impôts arabes » est ainsi aggravée par des cas fréquents de violence et de concussion de la part des percepteurs français ou algériens. L’examen des comptabilités municipales révèle des taxations abusives sur l’abattage, sur les marchés, sur les gourbis isolés, etc., ainsi que l’ampleur des détournements par le biais de travaux fictifs surtout. La distribution des secours privilégie encore les clients aux sinistrés ou affamés. La main-d’œuvre algérienne réquisitionnée dans la lutte contre les criquets ou « secourue » dans des chantiers de charité doit se contenter de 10-30 centimes journaliers quand elle est payée. Les largesses des départements et des communes, surendettés, vont ailleurs : dans les rémunérations des employés municipaux (premiers clients), dans des travaux qui n’intéressent que la minorité des électeurs, ou directement dans la poche des élus et de leurs complices.
La longue impunité des fonctionnaires modèle les comportements de l’ensemble de la population : ses déplacements, ses prises de parole, ses repères. Les abuseurs témoignent dans leurs dépositions de leur conscience ou non de l’abus. Avec ceux qui les dénoncent ou les défendent, ils s’approprient de façon originale des valeurs telles que : la loi, la justice, le patriotisme, l’honneur, le suffrage « universel » ou la sécurité. Confrontés quotidiennement à l’abus, les sujets algériens recourent fréquemment à diverses formes de dissimulation : silence, mensonge, arrachage de bornes de propriété, non-déclaration de matière imposable, etc. Ils participent aussi aux abus, plus ou moins directement, comme le fait d’aller à la mairie de telle commune éloignée où l’on sait pouvoir obtenir, contre 2, 5 ou 10 francs, un service indispensable : un permis de voyage en bonne et due forme, une immatriculation d’arme, un acte d’état civil, etc. Les auxiliaires algériens jouent dans ces opérations un rôle déterminant. Bien sûr, la résistance aux abus existe, courageuse, mais elle n’a pas de caractère national et se révèle souvent ambiguë. À la fin du xixe siècle, les tribus disloquées ne remplissent plus leur rôle d’entraide et la nécessité d’assurer le quotidien facilite le passage de l’état d’abusé à celui de complice. Il n’est même pas toujours facile de classer un comportement dans l’une ou l’autre de ces catégories.
Une reprise en main coûteuse pour la République (1898-1914)
Les antisémites sont parvenus au pouvoir en dénonçant les abus des autres et en abusant eux-mêmes : injures, calomnie, pressions électorales, violences contre les électeurs d’origine israélite. Mais leur incapacité notoire à administrer et la poursuite de l’agitation, entre 1898 et 1902, lassent rapidement les milieux d’affaires. En attendant, la population juive se retranche chez elle, terrorisée et privée de certains emplois par les municipalités antisémites. Les anciens réseaux de pouvoir, malmenés par la crise, se reconstituent progressivement. Leur discours insiste sur le « séparatisme » des chefs antisémites et sur le « péril étranger », représenté par les électeurs d’origine italienne ou espagnole en nombre croissant. Ils cherchent ainsi à reconquérir l’électorat français de souche qui est toujours le plus nombreux. L’accusation séparatiste, particulièrement efficace pour mettre le patriotisme de son côté, n’a pas de fondement : Drumont n’a rien d’un révolutionnaire et s’efforce de freiner les rêveries du jeune maire d’Alger Max Régis. Le financement du « parti antijuif », avec son électorat populaire, dépend plus que les autres du maintien du système de distribution clientéliste, décrit plus haut, associant étroitement l’Algérie à la métropole.
Contesté de tous côtés, le pouvoir central renonce à sa politique d’épuration en 1898 (cf. figures 1 et 2). Il y est forcé par l’ampleur des troubles car l’antisémitisme compte beaucoup de partisans dans l’administration : des policiers et des militaires sympathisent avec les casseurs ; des élus, soucieux de conserver leur mandat, excusent ou facilitent les débordements. Mais le spectacle du « désordre colonial » ne peut pas durer indéfiniment, au risque de s’étendre au monde « indigène ». La politique de défense républicaine menée en métropole par Waldeck-Rousseau, président du Conseil (1899-1902), prend tout son sens en Algérie : il s’agit bien de retrouver un soutien politique local et de mettre fin aux scandales qui affaiblissent l’autorité de l’État. Mais, pour cela, le gouvernement concède l’autonomie financière à la colonie (1900), ce qui enlève au Parlement un contrôle financier effectif. La discussion budgétaire était devenue, dans les années 1890, un moment de critiques intenses contre les abus de l’administration coloniale. À l’inverse, la création du budget spécial permet de rouvrir complètement le robinet des emprunts pour de grands travaux de colonisation. Les conditions d’éligibilité dans la nouvelle assemblée des délégués financiers donnent encore plus de poids à l’élément français de souche. Le cabinet Waldeck-Rousseau met donc « fin à la crise » ouverte en achetant le silence des élus locaux intéressés par des réformes qui facilitent davantage les abus. De même, la microrévolte de Margueritte (1901) est le prétexte à l’institution de « tribunaux répressifs » qui expédient plus sommairement la justice « indigène ». Les plaintes des sujets algériens se raréfient et sont de moins en moins relayées. La sanction des abus de pouvoir reprend mais contre les seuls élus antisémites qui persistent dans leur opposition au régime. Tous les transfuges sont acceptés pour peu qu’ils manifestent leur attachement à la République. Aux élections locales, de nouveaux préfets à poigne appliquent la consigne en soutenant les « bons » candidats. D’ailleurs, les électeurs comprennent vite lequel sera en mesure d’obtenir des crédits du gouvernement, une fois élu.
Ainsi, dès 1903, tous les fonctionnaires de la colonie sont à nouveau des républicains fervents, soutiens du régime. Le président de la République en profite pour visiter la colonie. L’événement est un modèle de mise en scène pour ne surtout rien voir et ne rien entendre des abus ; pour célébrer, au contraire, la réconciliation entre républicains. Il faut attendre les années 1910-1913 pour que l’Algérie et ses abus fassent de nouveau recette au Parlement et dans la presse parisienne, sous l’impulsion des socialistes et des « indigénophiles ». L’affaire de l’Ouenza et la suppression de l’internement administratif occupent alors les discussions (cf. figure 3). Mais les nouveaux « scandales algériens » n’éclaboussent plus les fonctionnaires locaux et ne sont donc pas suivis d’enquêtes ni de sanctions (cf. figures 1 et 2). De plus, avec la guerre de 1914, l’Union sacrée et la censure mettent fin à ces critiques.
Ainsi, la genèse administrative des années 1880-1914 aboutit à la violence « ordinaire », c’est-à-dire à des abus de pouvoir généralisés, quotidiens et impunis, qui s’enracinent en Algérie en même temps que la République. L’« extraordinaire » est relégué à un moment de crise (1891-1903) quand ces abus étaient dénoncés, recherchés et en partie sanctionnés. Le scandale met en lumière les fortes contradictions du régime républicain en situation coloniale. Ces contradictions le « corrompent »[30] durablement car, au début du xxe siècle, le gouvernement se contente d’enrayer le processus de découverte des abus. Trente ans plus tard, Jean Mélia, ancien chef de cabinet du gouverneur général, peut encore critiquer les « millions » dépensés en fonds de publicité qui
ont perverti la presse, et [...] fait croire au peuple français tout le contraire de ce qui se passe dans ses domaines d’outre-mer. Sénateurs et députés ne tournent leur attention sur nos colonies qu’à la suite d’un scandale ou de graves complications.[31]
Cette « politique de l’autruche » a contribué à amputer la République de sa composante coloniale, trop souvent considérée dans l’historiographie comme une « périphérie ». La genèse des années 1880-1914 révèle, au contraire, l’imbrication très forte entre la métropole et sa principale colonie.
[1] Claude Collot, Les institutions de l’Algérie durant la période coloniale (1830-1962). Alger-Paris : OPU-CNRS, 1987, p. 93.
[2] Gouvernement général de l’Algérie, Tableau général au 30 septembre 1884 des communes de plein exercice, mixtes et indigènes des trois départements d’Algérie. Alger : Fontana et Cie, 1885.
[3] Charles-Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France, 1871-1919. Paris : PUF, 2005 (1re édition 1968), 2 vol.
[4] Nous entendons par « crise » la fragilisation durable du régime républicain qui doit répondre de ses contradictions - entre principes libéraux et domination coloniale - face à l’indignation suscitée par les « scandales algériens » de 1891 à 1903.
[5] Nous entendons par « affaire » un cas d’abus de pouvoir documenté impliquant un fonctionnaire, un auxiliaire de l’État ou un candidat aux fonctions publiques. Cela ne présuppose aucunement du bruit donné à l’événement dans la presse locale ou nationale. La seule condition est la réalité des faits, établis par l’enquête parlementaire, financière, administrative ou judiciaire.
[6] Centre des Archives nationales d’Algérie (CANA), fonds « Intérieur et Beaux-Arts » (IBA) du gouvernement général, carton n° 1591.
[7] Pour la période 1880-1914, le principal noyau d’archives est constitué par des dossiers d’affaires produits par le gouvernement général (CANA, Alger), par le ministère de l’Intérieur (Centre des Archives d’Outre-mer, CAOM, Aix-en-Provence) et par le ministère de la Justice (Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales, CARAN, Paris). Les débats sur l’Algérie au Parlement ont fait l’objet d’un dépouillement systématique du Journal Officiel ; la couverture par la presse locale et nationale est connue par un dépouillement sélectif (CAOM ; Bibliothèque Nationale de France, Paris).
[8] Gouvernement général de l’Algérie, Tableau général des communes d’Algérie au 1er janvier 1897. Alger : Giralt, 1897.
[9] Le ministère conservateur, issu de la crise du 16 mai 1877, remplace 77 préfets, révoque 1 743 maires à cause de leurs opinions républicaines. Vainqueurs des élections législatives en octobre, les républicains procèdent jusqu’à 1883 à une épuration inverse du corps préfectoral, des magistrats du parquet, des juges de paix, etc. Voir Jean-Marie Mayeur, Les débuts de la IIIe République, 1871-1898. Paris : Seuil, 1973, p. 39-54.
[10] Note de juillet 1906, CANA, IBA, n° 36.
[11] CANA, IBA, n° 1856.
[12] CANA, IBA, n° 713 : rapport du procureur général d’Alger au gouverneur, 19 juin 1913.
[13] CANA, IBA, n° 713 : rapport du préfet de Constantine au gouverneur, 2 décembre 1913.
[14] Damien de Blic, Le scandale financier : naissance et déclin d’une forme politique de Panama au Crédit Lyonnais. Thèse de sciences politiques, 2003, 2 vol. ; Eric John Hobsbawm, L’ère des empires. Paris : Hachette, 2004, p. 15 ; Jean-Yves Mollier, Le scandale de Panama. Paris : Fayard, 1991.
[15] R. Casement, « The Congo report » (11 décembre 1903) et W. G. Washington, « An open letter to His Serene Majesty Leopold II » (18 juillet 1890). In M. Carter, B. Harlow (dir.), Archives of Empire, vol. II, The Scramble for Africa. Durham : Duke University Press, 2003, p. 715-727 et p. 770-780.
[16] Lincoln Steffens, The Shame of the Cities. New York : Dover Publications, 2004 (1re édition 1904, sous la forme de six articles dans le Mc Clure’s Magazine).
[17] Jean Garrigues, La République des hommes d’affaires (1870-1900). Paris : Aubier, 1997.
[18] Édouard Drumont, La France juive. Essai d’histoire contemporaine. Paris : Marpon-Flammarion, 1886, vol. I, p. viii.
[19] CAOM, F80 1826, rapport au préfet d’Alger, janvier 1903.
[20] Geneviève Dermenjian, La crise antijuive oranaise (1895-1905). L’antisémitisme dans l’Algérie coloniale. Paris : L’Harmattan, 1986.
[21] P. Hamelin, La crise antijuive algéroise de 1898 à 1902 : une révolution manquée. Université de Nantes, mémoire, 2003.
[22] Journal Officiel, séance au Sénat, 6 mars 1891.
[23] Fatiha Sifou a recensé les plaintes et pétitions en arabe conservées au service des « Affaires indigènes » du gouvernement général de l’Algérie : 4 entre 1875 et 1879 ; 12 entre 1885 et 1889 ; 23 entre 1895 et 1899 puis seulement 6 entre 1905 et 1909 (in La protestation algérienne contre la domination française, thèse, Université de Provence, 2004, t. 1, p. 287).
[24] Article dans La Vigie Algérienne, 9 septembre 1895.
[25] Alain Garrigou, Le vote et la vertu. Comment les Français sont devenus électeurs. Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1992 ; Raymond Huard, Le suffrage universel en France, 1848-1946. Paris : Aubier, 1991 ; Moisei Ostrogorski, La démocratie et les partis politiques. Paris : Fayard, 1993 (1re édition 1902).
[26] X. Huetz de Lemps, « La corruption au niveau provincial dans les Philippines de la seconde moitié du xixe siècle ». In M. Luque Talaván, J. J. Pacheco Onrubia, F. Palanco Aguado (dir.), 1898 : España y el Pacīfico. Interpretacīon del pasado, realidad del presente. Madrid : Asociacīon Española de Estudios del Pacīfico, 1999, p. 93-101 ; Colloque, Les élections législatives et sénatoriales outre-mer, Université de Nantes, novembre 2006. [http://www.parlements.org/colloques/06_elections_outremer.htm], consulté le 7 juin 2007.
[27] La notion de « facilitateur » est empruntée aux anthropologues : Jean-Pierre Olivier de Sardan, « L’économie morale de la corruption en Afrique », Politique africaine, octobre 1996, n° 63, p. 97-116.
[28] Résultat obtenu à partir du dépouillement de quelque 160 dossiers personnels de préfets, sous-préfets, conseillers et secrétaires généraux de préfecture, en poste en Algérie entre 1877 et 1914 (CARAN, série F1bI, Paris).
[29] Emmanuel Chadeau, Les inspecteurs des finances au xixe siècle (1850-1914), profil social et rôle économique. Paris : Economica, 1986.
[30] Au sens où Montesquieu l’entend, comme la « corruption » d’une pomme, son pourrissement.
[31] Jean Mélia, Le triste sort des indigènes musulmans d’Algérie. Paris : Mercure de France, 1935.
Citer cet article :
Didier Guignard, « La mise en place de ’administration coloniale en Algérie (1880-1914) », colloque Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne, 20-22 juin 2006, Lyon, ENS LSH, 2007,
http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=280